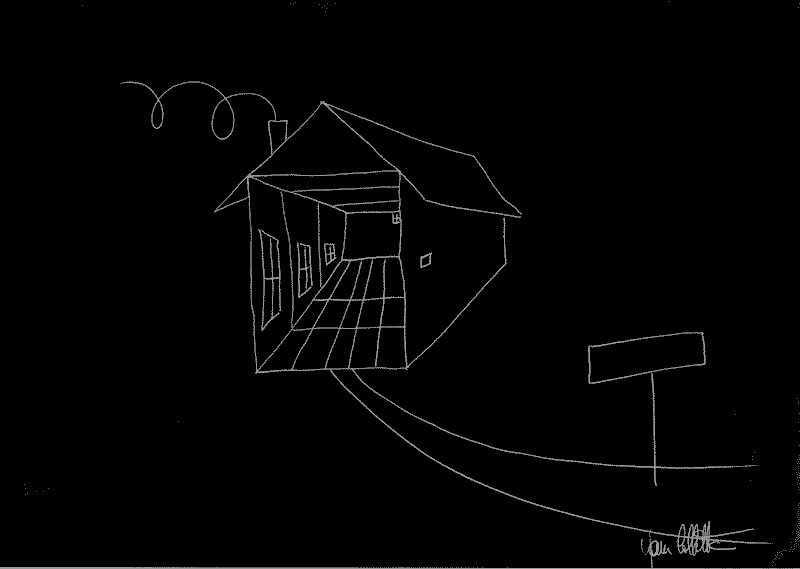C�line Minard nous �crit � propos de Miroirs noirs
� Bobigny :
J'ai lu votre critique de Miroirs noirs, la
pi�ce, sur le site et je trouve qu'elle est sympathique pour le travail du metteur en
sc�ne. Vous tirez l'ensemble vers le texte et tant mieux, c'est de loin ce qu'il y a de
mieux dans cette affaire. Car � vrai dire, plus le temps passe et plus je trouve que la
mise en s�ne manquait d'audace. Certainement parce-que, justement, le texte n'avait
jamais �t� adapt�. C'�tait presque 'en costume d'�poque'. Et pourtant, on ne peut pas
dire que Schmidt soit un auteur classique du d�but du si�cle ni un trag�dien grec.
D'ailleurs, maintenant, les metteurs en sc�ne font des choses os�es avec les vieilles
soupi�res ou les vieilles soupes. qui ferait encore un Oedipe en toge ?! Je pense qu'ils
ont eu peur du texte, de sa modernit�, de son c�t� radicalement dingue, des choses
terribles qu'on peut faire avec �a.
C'�tait finalement un peu trop tir� vers le burlesque,
par exemple quand le dernier homme �crit sa lettre au professeur am�ricain. Elle ne
manque pas d'humour cette lettre mais doit-elle faire rire vraiment ? Et puis le jeu de
l'actrice m'a agac�e, je n'aime pas les femmes-enfants, et dans ce cas, �a me semble
compl�tement d�plac�. Je ne sais pas, mais il me semble que les personnages f�minins
de Schmidt �chappent justement � tout un tas d'attirail d�bile qui "signe" la
femme (minauderies, coquetteries, b�tise, superficialit�, etc. ). Elles sont, dans tous
les textes que j'ai lus, bien loin de r�pondre � ce genre d'image, elles sont plus
physiques, plus triviales et plus subtiles que tout �a. Comme les rapports homme-femme
n'ont rien � voir avec ce qu'on peut trouver ailleurs comme clich�. Et heureusement, et
d'ailleurs, serait-il un grand �crivain s'il s'occupait de toutes ces v�tilles ? Le seul
moment o� le jeu de l'actrice "passe" c'est quand elle lit les trois pages du
r�cit d'enfance qu'elle a "command�", l�, on a l'impression au moins au
d�but qu'elle n'a jamais lu ce texte et c'est assez fort. Mais bon, tout le reste est
tellement aga�ant ... Quant � l'acteur (je me demande ce qu'aurait donn� un Quentin
Chatelain avec ce texte), je suis s�re qu'il �tait pr�t � aller plus loin. � �tre
plus inqui�tant, plus d�rangeant, plus jeune aussi. Bon, je ne suis pas tr�s gentille.
Parce qu'enfin, ce n'�tait tout de m�me pas du temps perdu et c'est vrai qu'il y avait
quelques trouvailles. Et puis, le texte. Il fallait quand m�me �tre courageux. "
Claude Riehl : R�ponse � C�line Minard.
Depuis toujours le th��tre s'est nourri des
"grands r�cits" pour pr�senter des fictions qui lui sont propres. Dans le cas
de Miroirs noirs � Bobigny, il y a une fiction autonome qui r�sulte d'un
travail dramaturgique et de l'interpr�tation des com�diens : rien de plus normal selon
moi, que le r�sultat sur sc�ne diff�re de votre ou de ma vision du texte. Il semble que
beaucoup de gens de th��tre s'int�resse � l'œuvre d'Arno Schmidt (en Allemagne
depuis longtemps d�j�). Vu la richesse de ses r�cits, il n'y a l� non plus rien
d'�tonnant. Et ce n'est pas le fait qu'il n'�crivait pas pour le th��tre qui y
changera quoi que ce soit. (Il l'a tout de m�me fait une fois, tout au d�but de sa
carri�re, lorsqu'il dicta fr�n�tiquement � sa femme Alice la " revue historique
" Massenbach). Les romans dialogiques des ann�es soixante et
soixante-dix font, bien entendu, de l'œil au th��tre, quoique � ma connaissance
notre auteur n'ait jamais pris de contact d'aucune sorte avec une troupe ou une
institution dans le but de voir repr�senter ces choses-l� sur une sc�ne. Il en allait
pour lui, avant tout, d'�largir le champ du romanesque. Pourtant il y a dans ces grands
textes appel�s " Com�die de nouvelles " (la notion vient de L'�pouvantail
de Tieck) ou " Farce-f�erie " (Nestroy, la com�die populaire viennoise) une
part de s�duction qui ne manquera pas un jour ou l'autre de faire des ravages sur nos
< tr�teaux> contemporains. Mais ce n'est pas de cela que je comptais parler. Je
vous dois une r�ponse quant � "l'image de la femme" dans l'œuvre d'Arno
Schmidt.
En premier lieu, je dois rappeler qu'il n'a jamais �t�
question de femme-enfant dans mon compte rendu de Miroirs noirs � Bobigny. Je
d�couvrais seulement – avec bonheur, je dois le dire – la dimension enfantine
que le metteur en sc�ne avait su mettre en relief dans le jeu de pens�es qui s'appelle
Miroirs noirs. L'id�e de la femme-enfant, si jamais cette id�e a quelque existence,
est absolument �trang�re au monde de l'enfance. La femme-enfant n'existerait que dans le
d�sir et la r�alit� affective et sexuelle de l'adulte. Et Lisa n'a rien � voir avec
une figure de ce type – ni dans le texte de Miroirs noirs, ni dans
son adaptation th��trale. Quoique vous disiez, Lisa minaude bel & bien, mais ce
n'est pas l� un des clich�s qui caract�risent la femme-enfant; � ce compte-l� le
narrateur en fait bien plus sur ce chapitre ! Ce qui ne l'emp�che pas – Lisa –
d'�tre une esp�ce de "Tania la Guerilla" d�crite ailleurs dans l'œuvre
de Schmidt. Il est vrai que l'adaptation � Bobigny a supprim� la sc�ne de western entre
les deux protagonistes : Lisa appara�t vaincue, tomb�e du ciel, tandis que dans le
roman, elle se bat comme un guerrier avant d'�tre "neutralis�e" par le
narrateur.
En second lieu, au-del� d'une approche n�gative, je ne
suis pas s�r de savoir pr�cis�ment ce que serait une femme-enfant. Il y a, me
semble-t-il, dans la litt�rature, la femme de Breton et celle de Nabokov qui pourraient
se rapprocher de cette id�e : mais qu'ont-elles de commun ? Comment d�finir par exemple
la Louve, K�the Ewers, de Sc�nes de la vie d'un faune par rapport �
ces deux mod�les ? Ce n'est pas parce qu'elle est encore une lyc�enne qu'elle serait une
femme-enfant. Au contraire, elle prend son plaisir avec D�ring en �tant consciente de sa
propre force de s�duction et en assumant enti�rement sa propre jouissance dans la
relation amoureuse. On peut dire que par la suite, dans l'œuvre de Schmidt, trois
sortes de femmes pr�dominent : la femme forte autonome, la femme bless�e mais non moins
autonome et l'adolescente qu'on serait tent� de nommer "Lolita" ou
"femme-enfant", qui en tout cas est l'objet de l'amour fou d'un homme beaucoup
plus �g�. Dans tous les cas, la relation amoureuse est pr�caire, son avenir incertain.
En fait, s'il existe une "femme-enfant" dans l'œuvre de Schmidt, ce serait
Franziska dans Zettel's Traum. On y apprend qu'elle a 16 ans mais sa
fa�on de se comporter nous laisse � penser qu'elle est bien plus jeune encore. Amoureuse
de Daniel Pagenstecher qui frise la cinquantaine, elle r�ussit � jouir de sa part
d'enfance avec lui sans r�ussir n�anmoins � partager et � satisfaire physiquement tous
ses d�sirs avec celui qui est au "soir de sa vie". La situation d'Ann'Ev' avec
A&O dans Soir bord� d'or est analogue, sauf qu'AE est sensiblement plus
�g�e (21 ans) et surtout qu'elle n'est plus tout � fait de ce monde – elle se dit
�tre une "demi-d�esse", ce qu'elle prouve d'ailleurs abondamment par ses
pouvoirs paranormaux. Quant � Martina (15 ans), la "vierge mal l�ch�e" de SbO,
elle focalise bien des d�sirs mais se trouve �tre une demoiselle tout ce qu'il y a de
plus normal pour l'�poque. Toutes ces "jeunesses" ont une �tonnante autonomie
: ce ne sont pas des tendrons n�s de la derni�re pluie, avec leur insolence physique et
intellectuelle, il n'est pas rare qu'elles m�nent les hommes par le bout du nez. Mais ce
n'est pas tout : elles exposent leur intimit� avec un art et un tact stup�fiants, qu'on
ne trouve nulle part ailleurs dans la litt�rature – je dirais m�me � faire rougir
le libertin le plus blas� et � d�sesp�rer les psychologues et les r�dacteurs des
magazines " pour ados ". Une intimit� qu'elles revendiquent dans ses plus
extr�mes singularit�s et r�fl�chissent " avec panache ".
" L'image de la femme " chez Arno Schmidt ne
rel�ve jamais du clich� et s'il y a une femme-enfant dans Zettel's Traum, il
faut comprendre ce terme au sens litt�ral : Franziska est � la fois femme & enfant,
donc un �tre qui n'existe pas dans la r�alit� et qui n'a strictement rien � voir avec
les caricatures que nous propose la mode � intervalles r�guliers.
C�line Minard, le 5 mars 2002
Que femme-enfant ne signifie pas grand-chose pour ne pas
dire rien du tout, nous sommes bien d'accord. C'�tait de ma part un abus de langage ou
une facilit� qui, en v�rit�, soul�ve bien des complications. Je n'utilisais pas cet
affreux double terme au sujet du personnage r�el (si on peut dire) mais plut�t au sujet
du jeu de l'actrice. Vous mettez le doigt dessus avec vos 'minauderies'. �a m'insupporte,
les minauderies. Vous soutenez que le narrateur en fait 10 fois plus. Je veux bien, mais
je n'ai jamais vu une femme minauder chez Schmidt.
Et d'ailleurs, cette histoire qu'il y aurait des
femmes-enfants chez Arno Schmidt (premier sens courant, dont on a vu qu'il n'�tait
justement pas tr�s clair), c'est pas possible. Peut-�tre Ann'Ev' donc, mais je ne la
connais pas suffisamment. Mettons, ce qui s'en rapprocherait le plus pour moi, ce serait
le personnage assez effac� qui accompagne bien des histoires d'Histoires et qui
s'incarne dans la peau d'une jeune fille aux jambes longues assez souvent nues, devant
laquelle tout ne serait pas bon � dire (et que reluque discr�tement le narrateur).
Celle-l� me semble assez proche encore d'une "vraie jeune fille", mais
finalement pas d'une femme-enfant, d�cid�ment, cet attribut ne d�signe rien. Quant aux
autres, elles peuvent avoir 10, 16 ou 50 ans sans aucun probl�me.
Peut-�tre direz-vous qu'une part de l'œuvre d'Arno
Schmidt m'est absolument ferm�e (et c'est s�rement vrai mais pas forc�ment celle-ci)
mais ce que je trouve de particuli�rement r�ussi dans ses personnages f�minins c'est
que pr�cis�ment ils le sont assez peu dans le sens convenu. Car elles sont effectivement
toutes autonomes. Or ce n'est pas du tout ce qui caract�rise une femme, l'autonomie. Je
dis bien, d'habitude, dans la litt�rature et ailleurs. Les �crivains – et je ne
fais l� aucune diff�rence de genre (les �crivains, les �crivaines) – ne sont pas
l�gion � inventer des personnages f�minins autonomes. J'en vois comme �a quelques-uns,
dont Manchette, chez qui la question de la f�minit� de la femme ne soit pas un
monstrueux bourbier sirupeux. Tania la Gu�rilla, il me semble qu'on peut la retrouver
dans toutes les femmes de Schmidt. Sans d�nier leur appartenance sexuelle (et c'est �a
qui est fort) elles sont des entit�s, des int�grit�s humaines et d�passent le genre,
� la vol�e.
Et crues, et tout �a, � faire p�lir les libertins blas�s, et surtout eux d'ailleurs,
j'en suis d'accord.
Par contre le 'rendu' th��tral d'une Lisa qui serait �
la fois femme et enfant (ce qui cette fois signifie vraiment quelque chose, comme homme et
enfant) n'�tait pas du tout au rendez-vous. Vous allez croire que je lui en veux � cette
actrice, et c'est un peu vrai, mais ses minauderies, essentiellement dans la voix,
�taient aussi la marque de fabrique d'un certain th��tre. Je pense assez pr�cis�ment
� une repr�sentation de Penth�sil�e au th�atre de la Bastille en 98 ou 99. Il s'agit
d'une fa�on de placer sa voix (son organe), toute particuli�re, qui fait ressortir la
texture femelle en m�me temps qu'une certaine b�tise imm�diatement imputable au beau
sexe. Vous entendez B.B. dire "et mes jambes, tu les aimes, mes jambes?" et vous
avez saisi. On s'habitue, c'est vrai. Mais c'est triste. Et c'est pas dans Schmidt !
Tijl Fiasse, le 15 mars 2002
Je vous fais mon effront� de m’interposer, comme
�a... le sujet me fascine : la femme-enfant. Allez, �a excusera bien
l’impolitesse.
Les mots & concepts (‘femme-enfant’) ont
beau ne renvoyer � rien de localisable (les OVNI ?...) par tous dans la
" r�alit� ", certains d’entre eux (‘femme-enfant’)
ont une f�cheuse tendance � obs�der assez d’esprits pour permettre, mettons, � un
m�c�ne d’inviter quelqu’un � �crire une histoire de la litt�rature sous cet
angle. Ce qui serait palpitant.
Ce qui est s�r : Arno Schmidt n’en fera pas
partie.
Il est rare qu’on trouve chez un auteur autant de
r�actualisations des st�r�otypes les plus hilarants du moyen-�ge. Pour ne parler que
de Soir bord� d'or, c’est peu de dire qu’il s’agit d’un plat
� consommer assaisonn� de quelques pages des <Quinze joies de Mariage>. Enfin,
cette bonne vieille misogynie (Je dis bonne parce que, comme les caract�ristiques
nationales, elle est utile, ne serait-ce que comme aune d’�cart, sans quoi on serait
bien tout � fait perdu.)
Qu’on prenne un billet-raccourci pour/par la
contr�e o� l’on traite des relations entre les auteurs et ce qu’ils peuvent
bien mettre sous ‘femme-enfant’.
On peut traiter le probl�me d’une mani�re
sociologique, politique, etc ; rappeler, par ex., cette banalit� que les auteurs des
ann�es 20-30, qui ont vu appara�tre le cheveu court chez la femme & la psychologie
qui en d�coule, ont �crit des textes pour le moins �pileptiques, vers le haut comme le
bas ; et �a va et �a vient, du surr�aliste qui id�alise au point de se rendre
ridicule aux Miller et C�line qui voient des Circ� & H�cate � tous les coins
de rues. Mais ce n’a jamais �t� qu’une pouss�e. Bonbon : " Si
ces auteurs se sont r�v�l�s de grands malades, la maladie existait d�j� �
l’�poque romantique : voyez Baudelaire ou qui vous voudrez : il lui faut
– s�par�ment (c’est essentiel !) – une hourri & un fant�me �
id�aliser. " Qu’une femme qu’on aime puisse en m�me temps avoir des
pulsions sexuelles (et, qui, sait, pourquoi pas pour vous...), ne viendrait jamais �
l’id�e d’un romantique. C’est pas moi qui le dit, c’est Goethe, que
les romantiques sont des malades. Et lui, peut-�tre le premier...
Il semblerait que, dans la version masculine du dossier,
le go�t et l’id�e d’inventer des absurdit�s telles que le concept de
femme-enfant provienne de l’incapacit� de consid�rer comme �tant dans l’ordre
des choses que... (j’ose ? Vas-y, Icare ! � tes
plumes/marques !... ) la femme soit un �tre non seulement dou� de raison, mais
dont la nature permette le raisonnement. Un fin connaisseur du moyen-�ge, et grand
catho-d�presso-expresso-tachyco-romantique, Miklos Szentkuthy pourra donc �crire avec
tout le s�rieux dont il est parfois capable que, mais oui, c’est triste mais
c’est comme �a : " Lorsqu’une femme pr�tendument intelligente
l’emporte en raison sur un homme, n’avons-nous pas affaire � la plus grotesque
des arlequinades ? "
Le probl�me, comme je l’entends, n’est pas
l�. Fort heureusement, on a �crit de bien belles choses avant le romantisme. De la
th�ologie, parfois. Et puis les paroles des serpents sur la domination de la femme par
l’homme se sont tellement incrust�es dans la cervelle des m�les/mamalujos que, par
grand froid contr� par force boissons alcoolis�es, les oreilles distraites entendent
des : " Ch’te jure, Joe ! Ce serpent, i raconte rien que des
conneries ! T’as raison, Earl ! C’est pas du tout comme il avait
promis, le spermant ! Et, Joe ? t’es toujours l� ? Ouais, Ned !
C’passque j’ai une id�e, Bill ! Si que c’est k’c’est
vraiment comme �a que �a va ici dans ce cabaret du n�ant (T’inqui�te,
Lomax ! C’est qu’une citachion !), ‘fin, les choses du monde, tu
vois ? Ben tu vois pas ? Que c’est leur beau cul qui fait tourner le
monde ? Ben alors moi j’dis : si qu’on sait pas les �pater, nos
animaux de compagnie dou�s de parole, avec des armas y des letras (T’inqui�te,
Pete ! C’est pas le tit’ d’un livre !), si qu’on inventait
des femmes-enfants ? Riche id�e ! Sur ce, vous reprendrez bien une
chaudepine/chopine ? "
Je trouve dans le Robert des noms communs,
femme-enfant : " Plut�t relation qu’essence : rapport �tabli
entre homme et femme qui tend � exclure le jugement personnel et le raisonnement chez la
femme pour ne conserver que le sentiment positif et l’admiration pour l’homme.
L’�ge n’a pas d’importance. On a vu des femmes-enfant de 108 ans. Un
forgeron allemand (Weland Schmidt) est d’ailleurs pass� � la post�rit� pour avoir
totalement banni ce type de relations de son oeuvre. "
- Dupont 1 : " Vous en voyez,
vous ? "
- Dupont 2 : " Je dirais m�me plus : je
les entends. "
- Dupont 1 : " La petite femme de
Blake ? "
- Dupont 2 : " Je dirais m�me plus : la
petite Nora qui n’a jamais appris � lire et dont il ne voulait surtout pas
qu’elle change ! "
- Dupont 1 : " Ou alors uniquement pour
admirer le boulot d’�criture de son homme ? "
- Dupont 2 : " C’est bien ce qu’on
disait, non ? "
- Dupont 1 : " Vaut mieux pas,
finalement ! Z’imaginez votre femme donnant un avis n�gatif sur notre enqu�te
en cours ? Brr ! "
- Dupont 2 : " Je dirais m�me plus :
j’en ai des frissons dans le dos."